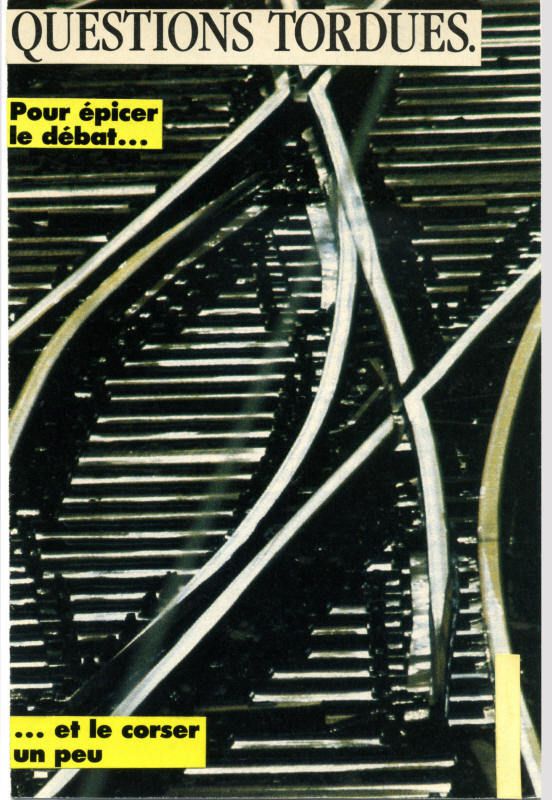« J’ai écrit ce livre entre les murs de la centrale de Lannemezan [5], cellule 204, en 1996/1997. Une période très dure. Je sortais juste des quartiers d’isolement, où l’on avait vécu des moments terribles, avec grèves de la faim et alimentation forcée. On pensait ne pas en sortir vivants, d’autant qu’on avait l’exemple de la RAF en tête [6]. Georges [Cipriani] était interné en hôpital psychiatrique, Nathalie [Ménigon] avait eu un AVC, si bien qu’on voyait ce qu’ils nous imposaient comme une forme d’élimination lente, par les conditions de détention. Il y avait donc l’idée de témoigner avant que ce ne soit plus possible, de laisser un document, le plus véridique possible. Évidemment, je ne pouvais pas raconter ce que les autorités ignoraient, ni les ramifications internationales de notre lutte. »
« J’ai tenu à ce que ce document reste « dans son jus », pur témoignage brut. Il n’était pas question de le censurer, parce qu’il appartient à d’autres personnes, notamment Joëlle [Aubron], laquelle était très présente dans le processus d’écriture et a retravaillé certains chapitres. Ceci dit, nous avons décidé avec l’éditeur de couper certains encarts politiques aujourd’hui indigestes, liés à l’époque. Hormis ceci, et les nombreuses notes de bas de page, c’est resté en l’état. »
« Écrire en prison est particulier. Ta vie quotidienne n’interfère en rien : tu peux t’y consacrer exclusivement. Et en même temps il y a des contraintes : après avoir été baluchonné [transféré], j’ai dû continuer le livre sur des cahiers d’écolier. Je me plongeais dedans tous les matins, à raison de 3 000 ou 4 000 signes quotidiens. Depuis, j’ai rédigé quinze bouquins, sous mon nom ou d’autres. Je me suis amélioré, dans la mesure où j’ai une capacité d’écriture beaucoup plus développée. C’est sans doute pour cela que j’écrirais différemment ce récit aujourd’hui. Parce que j’ai compris que la réalité sort souvent mieux d’un univers fictionnel que d’un document. Les livres qui se veulent les plus véridiques sont souvent les plus mensongers. »
« Reste que je suis proche de l’écriture prolétarienne : j’écris pour témoigner, décrire une situation d’exploitation ou d’oppression. Quand je me penche sur l’expérience carcérale, par exemple, je ne parle pas de ma prison, mais de nos prisons. C’était pareil avec les chroniques CQFD, où j’abordais le cas d’autres prisonniers. Mon cas personnel, je m’en fous. »
« Quand j’ai relu ce texte dix ans après l’avoir écrit, ma première réaction a été : ça va pas m’aider… Il faut dire que c’est un récit froid, d’une sobriété absolue, même dans les événements les plus glaçants. Quand tu détailles la mort d’un camarade abattu par la police ou la décision de tuer, tu es forcément dans quelque chose de dérangeant. Et qui va contre l’image romantique de la lutte armée. Car la vérité est cruelle : c’est du sang et de la terreur. Blood, sweat and tears [7]. Ceci dit, il faut nuancer. On n’était pas des moines guerriers. Et pas du tout versés dans le mortifère. On faisait la fête régulièrement. Et il y avait des moments de grâce : je me souviens notamment de ce match de foot épique opposant AD à la RAF. Mais on savait que le temps nous était compté, que ça allait mal finir, un jour. En attendant, on avait un sentiment de liberté immense, grisant. »
L’État, les médias et les universitaires ont vite eu une obsession : résumer notre histoire à quatre personnages paumés. Il s’agissait de fabriquer des stéréotypes. Moi j’étais l’antifasciste perdu qui s’était battu en Espagne contre Franco avant de dériver. Et les autres figures avaient droit au même traitement. Mais cette réécriture est totalement illogique : si on avait juste été quatre paumés, on n’aurait jamais tenu pendant dix ans. AD était une organisation conséquente, avec beaucoup de gens impliqués, de soutiens, de réseaux. »
« Avant qu’AD ne lance sa première action en 1979, le mitraillage du siège du CNPF [8], d’autres organisations étaient impliquées dans la lutte armée, comme les Napap [9]. Jusqu’à 1975, il y avait plus d’actions sanglantes en France qu’en Italie. Le storytelling consistant à dire qu’il ne s’est rien passé en France en matière de lutte armée est totalement mensonger. Quand le pouvoir nous réduit à quatre militants, ça devient anecdotique : des fous qui se lancent dans quelque chose qui les dépasse. Un truc de tarés. Comme cette histoire selon laquelle on tuait par ordre alphabétique (Audran, puis Besse, puis…). On nous a individualisés pour nous criminaliser. Et pour dire qu’on était des exceptions, qu’il ne s’était rien passé en France, contrairement à l’Italie ou à l’Allemagne. Ça reste le discours d’un Joffrin aujourd’hui [10]. Et c’est un mensonge historique. »
« Il faut rappeler que l’on s’inscrivait dans une période d’agitation généralisée. En 1977, on était en pleine insurrection autonome. Il se passait plein de choses, avec un terreau très vivace. Il y a notamment eu cette manifestation très dure, où des gendarmes mobiles avaient été laissés sur le carreau. Et les actions des sidérurgistes auxquelles on s’est greffés étaient d’une intensité impressionnante. »
« Il y a aussi quelque chose qui dépasse l’analyse politique, relève presque de l’effet de souffle. Une génération entière s’est levée sur les braises de 1968. Et on en était les fruits. Pour nous, il s’agissait de porter ce combat jusqu’au bout, même si cela impliquait d’aller trop loin. On a porté cette fulgurance, dans nos erreurs même, d’avoir été d’une fidélité absolue aux mots d’ordre des années 1960 et 1970. »
« Ce souffle brûlant a parcouru notre génération, notre continent, nos vies. Voilà pourquoi nous n’étions pas repliés sur des chapelles, mais dans la continuité, la synthèse. On était aussi bien issus de l’insurrection autonome des années 1970 que des campagnes des Brigades rouges (BR) et de la RAF. Il n’y avait pas de volonté d’avant-garde, on croyait simplement au mouvement de masse, qui impliquait toutes sortes de personnes, des maoïstes, des anars, des punks. Et l’on s’inscrivait dans une véritable fourmilière, qui mêlait aussi bien des Italiens que des Palestiniens ou des Turcs, avec une construction commune. On allait tous dans le même sens. Ce qui importait c’était ce qu’on faisait, pas les idéologies. »
Le livre permet aussi de détailler des pans beaucoup moins connus de notre histoire. Par exemple la période où nous avons été impliqués dans les luttes des squats à Barbès, aux côtés de travailleurs immigrés. On s’est installés dans ce quartier parisien après l’amnistie du pouvoir mitterrandien, au moment où il y avait une arrivée massive de militants turcs, chassés par le coup d’État des militaires dans leur pays. C’étaient des militants révolutionnaires très bien formés, déterminés. Ils apportaient avec eux le souffle du tiers-monde, les luttes réelles du nouveau prolétariat. C’était une respiration hallucinante, de l’oxygène à forte dose, parce qu’ils comprenaient réellement les enjeux de la lutte armée. »
« Notre volonté d’internationaliser la lutte a vite provoqué une répression. Quand on écrivait nos communiqués de revendication en arabe, c’était pour l’État une déclaration de guerre. Parce qu’on touchait au cœur de l’oppression de la classe ouvrière, à savoir les OS [11], arabes ou africains. De même, attaquer le siège d’Interpol comme on l’a fait en 1986 était tout sauf anodin. Le pouvoir socialiste a essayé de négocier un moment, cherchant à pacifier la région parisienne. Mais la branche qui a refusé la main tendue a fait face à une virulence extrême. Ç’a été une guerre totale. »
« Face à cela, on a pris la décision lourde de ne pas quitter la France. On aurait pu partir en Amérique du Sud ou en Algérie, rejoindre des luttes sur place, mais on a choisi d’assumer, de refuser de baisser les yeux. Il ne s’agissait pas d’orgueil, mais de politique. Pourquoi les derniers combattants de la Commune se battent-ils encore quand tout est perdu, dans la montée du passage Julien-Lacroix, sur les dernières barricades ? Parce que reculer à ce moment-là invaliderait tout le reste. C’est un sentiment que tu ne peux saisir que dans l’affrontement total, quand ta peau fait partie d’un tout et que préserver ce tout implique de perdre la vie. »
« C’était pareil en Espagne pour les combattants républicains après la bataille de l’Èbre : ils ne lâchaient pas les armes alors que tout était perdu. »
« C’était évidemment très compliqué de se retrouver dehors après un quart de siècle. Les séquelles n’étaient pas seulement physiques, mais également existentielles. D’abord parce que j’étais un rescapé. Des quatre qui ont été enfermés sur le long terme, je suis le seul qui a une parole plus ou moins tranquille, qui ne vit pas dans le drame. Et la question s’est vite posée : pourquoi moi ? »
« Autre point qui m’a marqué lors de ma première libération : l’ampleur de notre défaite. Découvrant ce qui avait changé, je me mettais à la place des camarades restés libres, avec cette interrogation : comment ont-ils pu accepter ? Comment la situation présente est-elle imaginable ? Tout le monde s’est mis dans des refuges, des coquilles, des niches. En prison, je trouvais beaucoup plus de solidarité ; il y avait des luttes, des prisonniers politiques. Et à l’extérieur j’étais considéré comme un abruti parce que je parlais de communauté. »
« Je nous vois comme des lapins pris dans les phares, sans aucune vision d’horizon à dépasser. Notre génération a laissé réécrire l’histoire à un point qu’elle est méconnaissable, inhumaine. Certains disent que par notre échec on a condamné les révoltes. Mais je ne suis pas d’accord. C’est simplement que tout le monde a accepté le ronron gauchiste, la subversion permise. Et aujourd’hui c’est très difficilement audible : on ne fait rien que le système pourrait considérer comme une attaque. Parce que le cycle des années 1960 et 1970 est vraiment fini. On a mis du temps à comprendre que la fin d’AD s’inscrivait dans le début d’une nouvelle période, le néolibéralisme. Soit le passage d’une histoire qui avait un sens à une inhumanité généralisée. »




 e, un poème.
linter
e, un poème.
linter





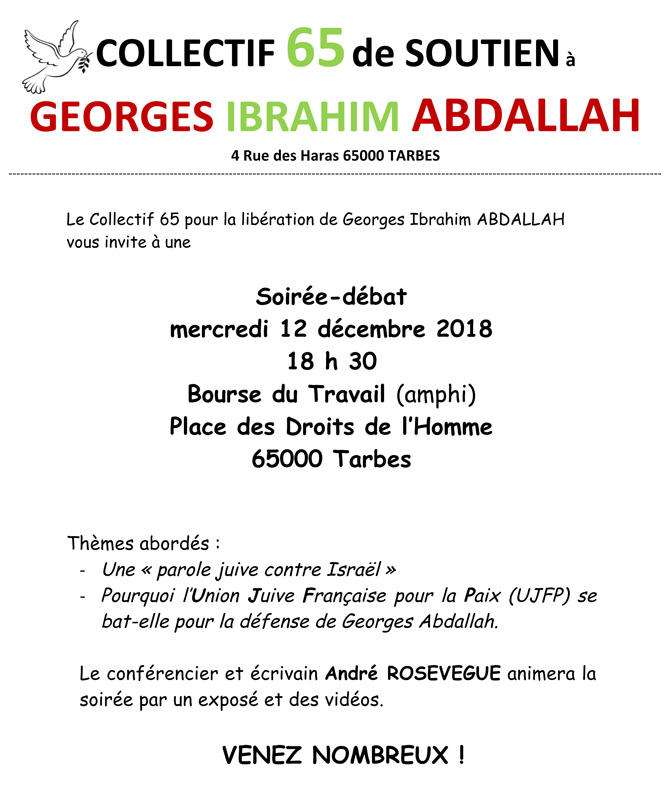



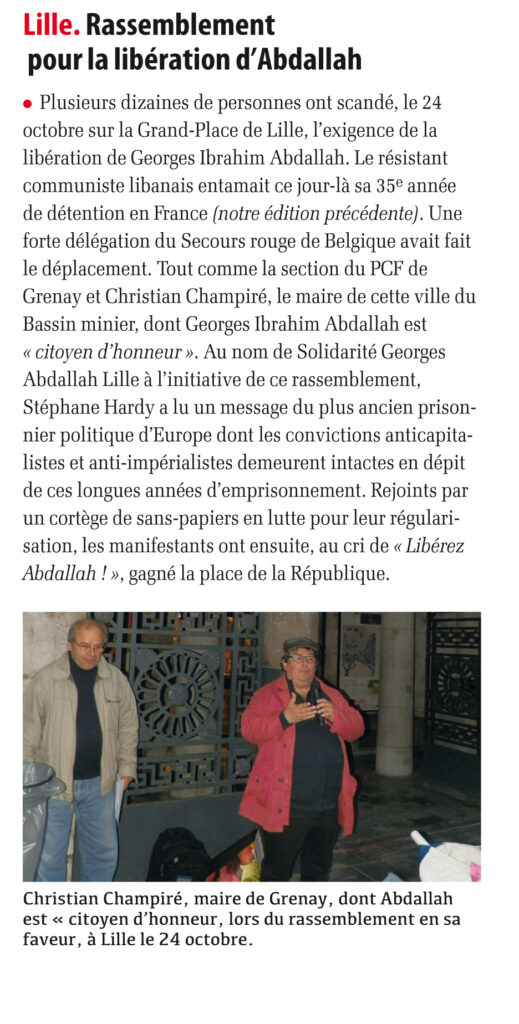 ☞ dans Siné Mensuel de novembre, l’article de Nadir Dendoune :
☞ dans Siné Mensuel de novembre, l’article de Nadir Dendoune :