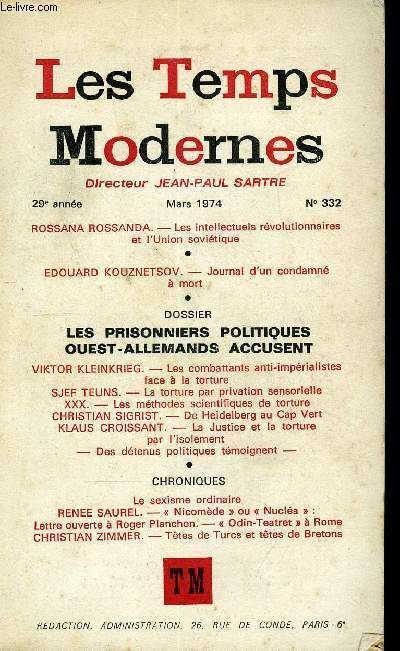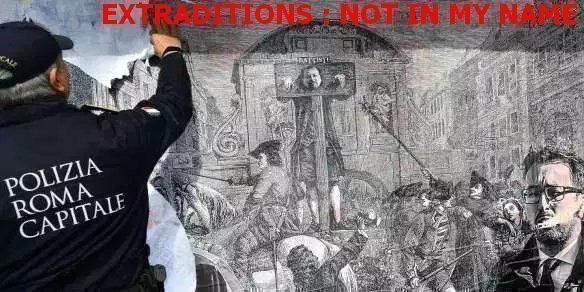Article publié en octobre 2012. Important à relire alors que l'on sait le risque de voir l'état d'urgence s'inscrire dans la constitution même. Pour consulter le blog: linter.over-blog.com
-------------------------------------------------------------
Nous reproduisons ici dans nos archives l'éditorial des Temps modernes du numéro de mars-avril 1956 sur ces pouvoirs "si" spéciaux. (P 1345- 1353)

La gauche pour une fois unanime, a voté les "pouvoirs spéciaux", ces pouvoirs parfaitement inutiles pour la négociation, mais indispensables pour la poursuite et l'aggravation de la guerre. Ce vote est scandaleux et risque d'être irréparable. Bien sûr, on peut et il faut l'expliquer, mais, pour être honnête, l'explication ne doit pas nier le scandale, bien au contraire: on ne songerait pas à justifier ce vote, si précisément, il n'apparaissait d'abord comme injustifiable.
Les partis de gauche, il est vrai, n'ont pas été les seuls à voter ce projet. Rarement, vit-on majorité plus hétérogène. Tous les votes "massifs" sont d'ailleurs équivoques : du côté des partis, ils comportent une menace - défense de faire la politique que les autres préconisent - plutôt qu'un mandat - faire celle que nous souhaitons ; du côté du gouvernement, une hypocrisie presque avouée. Mais aujourd'hui, l'équivoque est à son comble: ont voté le projet, M. Reynaud qui veut la guerre et ne s'en cache pas, M. Hernu qui préférerait la négociation, M. Soustelle, pour qui négocier, c'est capituler, M. Duclos qui affirme la nécessité de reconnaître d'abord le fait national algérien et les socialistes qui font silencieusement confiance au gouvernement bénéficiaire de ces suffrages contradictoires. C'est cette équivoque qu'on voudrait rassurante ; elle aurait heureusement stérilisé un projet dont la vérité eût été dangereusement soulignée par un scrutin trop clair. Toute la question est donc de savoir ce qui sera déterminant ; la politique qu'implique le texte où l'incohérence des suffrages. Celle-ci atténuera-t-elle celle-là? Mais suffit-il d'atténuer? La mise en pratique des "pouvoirs spéciaux" ne rendra-t-elle pas dérisoire une tactique, qui ne fut peut-être que le déguisement de la résignation? Aussi bien l'équivoque du vote ne concerne-t-elle que le vote lui-même, non la portée du projet, dont elle constitue en fait un aveu explicite: Si l'on a pu vouloir camoufler la signification des pouvoirs accordés au gouvernement, c'est bien parce que cette signification ne souffre pas la discussion. Croit-on que les Algériens vont s'y tromper? La droite de l'Assemblée, en tous cas, n'a pas nourri une bien longue inquiétude: il a suffi que M. Mollet réponde superbement qu'il ferait sa politique, c'est-à-dire celle de de son projet, pour que M. Bidault, qui l'avait sommé de lever l'équivoque, se sente aussitôt tranquillisé. Il sait bien que les faits et la logique de la situation resteront de son côté, si l'on se contente de les recouvrir de la phraséologie traditionnelle.
Bien entendu, le projet annonce d'impressionantes réformes sur les plans économiques et social. Qu'est-ce que cela coûte? Voilà longtemps qu'on promet aux Algériens d'améliorer leur sort, de ne plus les traiter en occupants sans titre de leur propre sol. On leur a fait, dans le passé, tant de promesses, qu'on a fini par croire qu'elles ont été tenues et qu'on s'étonne de l'ingratitude de ces gens qui ont le mauvais esprit de ne pas s'en apercevoir! Aujourd'hui, quand un gouvernement français promet quelque chose, même s'il est sincère, il ne peut être cru. Le premier qui voudrait réellement agir devrait se garder de l'annoncer, car il lui suffirait de proclamer ses bonnes intentions, pour qu'il soit aussitôt, et à bon droit, soupçonné de mentir. Comprendre enfin cette méfiance justifiée par tant de précédents, telle est la condition probable pour définir une politique susceptible de convaincre les Algériens. Voià pourquoi il est vain de porter à l'actif du gouvernement les bonnes intentions qu'il affiche et de justifier ainsi le soutien qu'on lui apporte.
Leur sincérité serait d'ailleurs la preuve de leur sottise. Imaginer que le problème algérien est d'abord un problème économique et social, c'est au fond admettre comme intangible le fait même de la colonisation. Celle-ci, voudrait-on faire croire, aurait donné lieu à des abus et c'est pourquoi des réformes seraient nécessaires. Mais les abus de la colonisation sont la colonisation même. Croire qu'on y mettra fin, un par un, c'est les considérer comme de simples accidents qui auraient pu être évités, alors qu'ils sont les éléments d'un système. On ne saurait donc les abolir sans mettre en cause le système lui-même, c'est-à-dire l'oppression coloniale. Affirmer le contraire, c'est vouloir la maintenir, ou, si l'on est de bonne foi, se condamner à l'impuissance. Le problème est donc d'abord politique: c'est une question de souveraineté. Le gouvernement ne peut l'ignorer, sans quoi il ne se livrerait pas à ses acrobaties verbales. Quand M. Mollet parle de "respecter la personnalité algérienne", quand il reconnaît aux Algériens cette "dignité" qui est l'éminente vertu du pauvre destiné à le rester, c'est très précisément pour ne pas parler du "fait national algérien". Invoquer la "personnalité algérienne", c'est simplement substituer à la fiction trop décriée de "l'Algérie, trois départements français", celle d'une Algérie-province aux traits si particuliers qu'elle pose "un problème unique au monde" - ce qui dispense de lui trouver une solution. Des réformes économiques et sociales, certes, il en faut, mais elles n'auront de portée que dans la perspective d'une reconnaissance du droit à l'indépendance, cette indépendance qu'on n'ose plus disputer à la Tunisie et au Maroc.
Admettons pourtant qu'on puisse les promouvoir à la façon dont l'entend le gouvernement et que celui-ci veuille vraiment les mettre en oeuvre. Il faut alors donner raison à ses adversaires (ou tout simplement à ses partisans) de droite : c'est bien pourquoi elle ne les inquiète pas ! Prétendre mener de front ce qu'on appelle pudiquement la pacification et les réformes, c'est une plaisanterie, qui malheureusement semble recueillir quelque crédit auprès des partis de gauche. On ne réformera vraiment la structure économique et sociale de l'Algérie que dans la paix. Il est absurde par exemple de penser qu'on pourra même amorcer une réforme du régime foncier dans le climat actuel et quand le tiers de l'Algérie échappe au contrôle des autorités françaises. Si donc on rejette toute idée de paix négociée, les réformes seront nécessairement postérieures au "rétablissement de l'ordre", si jamais il a lieu et si l'on y songe encore. Dans les circonstances présentes, mettre au premier plan l'urgence des réformes, ou bien c'est parler pour ne rien dire, ou bien, et très logiquement, c'est sous-entendre qu'un succès militaire rapide - et donc l'intensification de la guerre - est le seul moyen de respecter cette urgence. C'est par conséquent nier celle-ci au moment où on l'affirme, puisqu'il faut alors nécessairement renforcer d'abord l'appareil répressif. Il n'a d'ailleurs pas fallu attendre longtemps pour le vérifier : les "pouvoirs spéciaux" étaient à peine votés que des mesures militaires étaient seules décidées, que les journaux ne s'interrogeaient sur rien d'autre que sur leur efficacité et qu'une campagne de presse tendait à préparer l'opinion à une aggravation de la situation et aux décisions qui pourraient être prises pour y faire face. Autrement dit, quelle que soit la perspective choisie, le problème des réformes ne pourra être honnêtement posé qu'une fois la paix revenue. La seule question est de savoir si cette paix sera celle de l'oppression pour un temps réaffermie ou le fruit d'une négociation sans doute difficile mais loyale. Dans le premier cas, il est peu probable qu'elles voient jamais le jour; dans le second, elles seront l'oeuvre du peuple algérien. C'est ici que M. Bourgeaud éclate de rire: il sait bien, ce démocrate, que le mouvement national algérien est aux mains de féodaux moyennâgeux. C'est l'histoire de la paille et de la poutre. Répondons-lui simplement que si les réformes ne sont pas entreprises par les Algériens, elles ne le seront par personne, et que nous ne pouvons contribuer à cette oeuvre nécessaire qu'en combattant avec les Algériens la seule tyrannie qu'ils connaissent aujourd'hui : la tyrannie coloniale.
De quelque façon qu'on la considère, la loi sur les "pouvoirs spéciaux" n'a donc de sens que par et pour la guerre. Comment s'en étonner? Ce texte est parfaitement dans la ligne de la politique suivie par M. Mollet depuis son arrivée au pouvoir. Le passé de ce gouvernement prépare son avenir. Mais aurait-il une politique cachée, qui justifierait la confiance mitigée que certains lui accordaient encore? Ne feindrait-il pas de poursuivre une politique que pour en dissimuler une autre? Qu'est-ce qui, dans dans ses actes, annonce donc qu'il compte malgré tout rechercher la paix? A Alger, il cède à l'émeute des ultras; à Paris, il interdit les manifestations contre la guerre. Qu'est-ce qui permet de croire, comme le suggérèrent les esprits forts, qu'il n'utilisera pas les pouvoirs spéciaux? En fait, tous ses actes depuis qu'il est au pouvoir, contredisent une déclaration d'investiture pourtant timide : il démissionne Catroux, envoie des renforts, demande aux combattants de déposer les armes sans garantie ni contrepartie, confie à M. Lejeune, qui veut se faire pardonner son antimilitarisme de jeune homme, le soin de galvaniser une armée elle-même travaillée par le doute. Tout ce qu'il y a de positif dans la politique gouvernementale va dans le sens de la guerre. Reste, dira-t-on, la non-exécution des condamnés à mort. Voilà où nous en sommes : le gouvernement Faure-Pinay n'osait pas davantage et il faudrait y voir une preuve de sa bonne volonté! Et encore n'est-ce qu'un sursis, qui chaque jour peut prendre fin : une menace autant qu'une grâce. On reconnaît bien là le style de M. Mollet, de sa fade rhétorique qui indéfiniment balance entre la fermeté et la douceur, prétend à la fois intimider et concilier. Le 28 février, il lance un appel radiophonique, au nom de la France, mais à qui? Un appel à la confiance - sans autre garantie qu'un siècle d'oppression et de mensonge - a de toute façon peu de chances d'être entendu, et moins encore quand par surcroît il s'adresse à ceux, qui, en s'insurgeant, montrent assez clairement que la confiance est perdue. En vérité, M. Mollet sait bien qu'il ne sera pas répondu à son appel-ultimatum. Il a beau le faire répandre à des centaines de milliers d'exemplaires dans les montagnes d'Algérie, ce n'est pas aux fellaghas qu'il le destine, mais à lui-même. Il soupire à la radio en espérant que les armes, magiquement, se tairont : c'est pour se consoler de préparer déjà, dans un "sursaut" viril et navré, les siennes.
Au mieux, ce qu'on peut attendre d'un tel homme, s'il doit finalement reculer devant la guerre totale, c'est ce qu'on a appelé pour l'Indochine le pourrissement du conflit. Il y installera la France, mais il est à craindre que d'autres prendront très vite la relève et le conduiront jusqu'à son terme : la catastrophe après, peut-être, une victoire passagère et ignominieuse. En 1947 aussi, quand débuta la guerre du Viet-Nam, les socialistes étaient au pouvoir. Alors, aussi, ils disaient qu'ils ne voulaient pas la guerre, mais ils l'ont faite : irréparablement. Le langage, les thèmes sont déjà les mêmes : nous n'aurions en face de nous que des bandes rebelles, assurant leur emprise sur les populations locales par une propagande mensongère et par la terreur, et soutenues par l'étranger. Pékin hier, aujourd'hui Le Caire; quant à la défense du "monde libre", elle n'est pas loin!
Comme en Indochine, le seul point fixe de toute cette politique, c'est le refus de négocier avec ceux contre qui l'on se bat. Mais Dien-Bien-Phu n'est pas encore oublié. Il faut donc cette fois-ci justifier ce refus. Le grand argument, c'est l'absence "d'interlocuteur valable". Comme s'il y avait de quoi se vanter, comme si cela ne révélait pas l'état d'abaissement dans lequel on a tenu longtemps l'Algérie, on déclare gravement qu'il n'existe pas là-bas de mouvement politique comparable au Neo-Destour en Tunisie ou à l'Istiqlal au Maroc. En fait, on sait parfaitement quels contacts il faudrait prendre pour préparer une négociation. Mais justement, dit-on, alors, contrairement à ce qui s'est passé en Tunisie ou au Maroc, ces contacts n'ont jamais existé. Comment les nouer si nos adversaires ne s'y prêtent pas? Comprenons d'abord leur méfiance: au Maroc et en Tunisie, nous n'avons pas systématiquement comme en Algérie déconsidéré les leaders nationalistes, et surtout nous n'y avons pas massacré quarante mille hommes comme en 1945 dans le Constantinois! De bonnes paroles ne suffiront pas à dissiper cette méfiance. Il faudrait pour y parvenir des mesures sans équivoque, telle la libération des détenus politiques, que M. Mollet avait envisagée dans sa déclaration d'investiture, mais dont, après son voyage à Alger, il n'a plus rien dit. Il parle aujourd'hui d'élections libres : elles permettront, dit-il, de connaître les authentiques représentants de la population algérienne, ceux avec qui il sera possible de discuter. Candeur ou duplicité? Les Algériens ont une certaine expérience des élections auxquelles on les convie régulièrement pour désigner quelques créatures de l'administration. Il faudrait cette fois leur donner des garanties certaines quant à la loyauté de ces élections. Et surtout, le problème est le même que pour les réformes : les élections libres supposent la paix, elles n'auront pas lieu, ou seront aussi truquées que les réformes seront vides de sens, si l'on rejette toute idée de paix négociée. Mais qu'est-ce donc qui hérisse tant de gens dans l'idée de négociation? C'est la pensée qu'en négociant, on abandonnerait un million et demi de Français établis en Algérie. Le gouvernement et sa presse jouent de cette crainte avec une virtuosité de maitre-chanteur. Ils reprochent volontiers aux partisans de la négociation de confondre la masse des Français avec une "poignée" d'extrémistes, les intérêts des premiers avec les privilèges des gros colons. Mais cette confusion, c'est au contraire le gouvernement qui la commet et l'entretient, car, en faisant la guerre, ce sont ces privilèges seuls qu'il défend tout en voulant faire croire qu'il défend aussi ces intérêts.En fait, les Français ont tout à perdre dans la poursuite de la guerre, alors que la négociation ne leur fermerait pasl'avenir: bien plus, elle constitue pour eux, la seule issue. Les Algériens n'entendront pas raison, disent-ils, ils veulent nous jeter à la mer! Comment le savoir, si l'on refuse tout dialogie? Négocier, ce n'est pas capituer, sauf pour M. Soustelle qui a engagé tout son crédit dans la guerre. Négocier, c'est précisément faire valoir ce qu'on croit être ses droits, c'est confronter et adapter des perspectives d'abord et normalement divergentes. Cela ne suppose qu'un seul abandon préalable : celui du recours à la force. C'est pourquoi le premier objet d'une négociation serait aujourd'hui un cessez-le-feu. Une telle négocaition impliquerait évidemment qu'on reconnaisse ce que représente ceux qui nous combattent: la réalité nationale algérienne.Mais la guerre n'en constitue-t-elle pas déjà la reconnaissance par l'absurde? Il faut beaucoup de mauvaise foi pour refuser cette conclusion.
MM. Mollet et Lacoste semblent n'en pas manquer. Il faut donc poser à nouveau la question ; si cette politique est sans excuse, si elle aggrave une guerre honteuse et absurde, pourquoi ne l'avoir pas dit? Car il est peu croyable que les radicaux mendessistes, les communistes et même la plupart des socialistes ne s'en rendent pas compte. Ils n'ont maintenu aucune équivoque car il n'en existait pas. Ils ont espéré en créer une, obscurcir une politique qui sans leur appui serait trop claire. Mendès-France et quelques ministres socialistes jouent, dit-on, les otages à l'intérieur du gouvernement, mais leur présence finirait par faire basculer le corps mou et sans tête du gouvernement vers la négociation. Les communistes, à l'extérieur, feraient de même. Pris entre ces deux forces douces, le gouvernement serait conduit malgré lui à travailler pour lapaix. C'est oublier que d'autres forces aussi s'exercent sur le gouvernement et qu'elles l'emporteront d'autant plus aisément qu'on laissera celui-ci mettre en place tous les moyens de la guerre. On conçoit qu'il est difficile aux communistes d'abandonner les chances entraperçues de l'unité d'action, de compromettre la nouvelle politique internationale que laissait timidement entrevoir le discours de Pineau. Mais le prix à payer pour le Front populaire et la coexistence ne saurait être la guerre en Algérie. Qu'elle se poursuive encore et il faudra bien abandonner ce gouvernement à son sort. Seulement, on ne décroche pas si aisément d'une politique, dont on vient, quoi qu'on en dise, d'accepter les prémisses. Vouloir à tout prix se donner bonne conscience ne suffit pas, il est vrai, pour choisir une politique. On a le droit de ne pas accepter d'emblée de se trouver seuls à nouveau pour des années à dénoncer une "sale guerre", qu'on aurait en fait laissé se poursuivre. Mais on accepte alors de partager les responsabilités d'une action, sur laquelle on ne garde qu'une prise incertaine. c'est un risque. Souhaitons que ce ne soit pas une erreur.
18 mars.
T.M.




 e, un poème.
linter
e, un poème.
linter